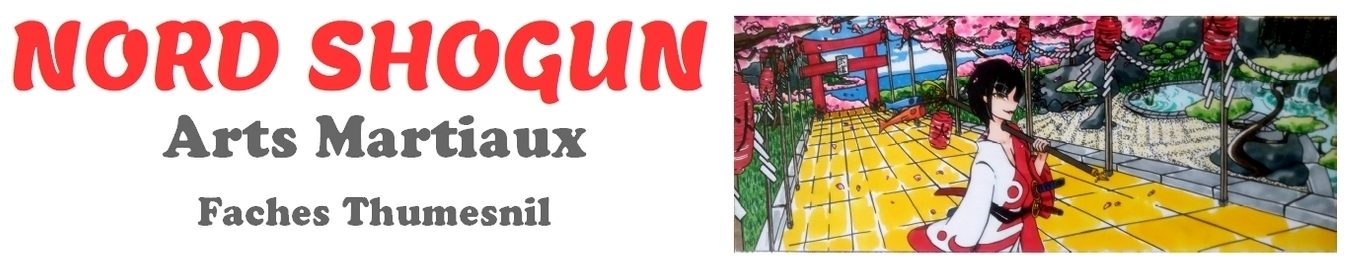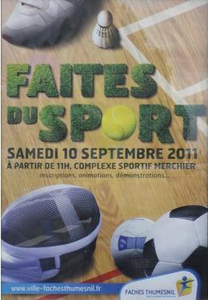Faîtes du Sport 2012
Samedi 8 septembre à partir de 11h au complexe Merchier, rue Henri Dillies.
Les clubs de la ville vous feront partager leur passion sur leur stand et certains vous proposeront une initiation gratuite. Pour animer l’après-midi, dès 14h, les clubs réaliseront des démonstrations.
En retirant un dossier à l’entrée de la salle et en faisant le tour des stands pour recueillir le tampon de chaque club, une réduction de 15 euros sera déduite de toute nouvelle adhésion réalisée par une femme ou une personne de moins de 20 ans dans un club de la ville.
Notre club sera présent, proposera une initiation et effectuera une démonstration dans l’après-midi.